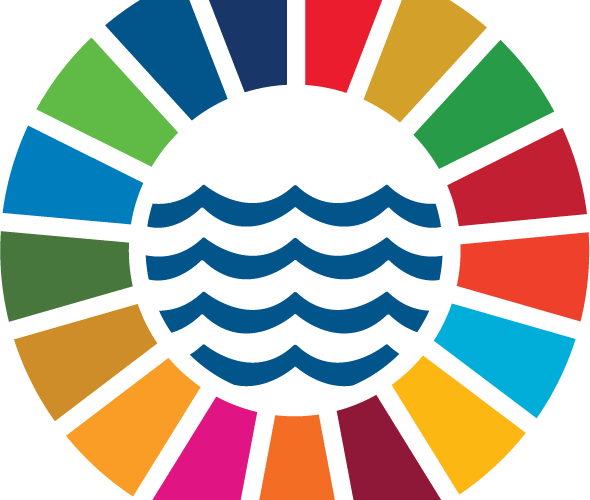Crises oubliées : Haïti
Lire le document pdf avec références
Introduction
La République d’Haïti partage le territoire l’île d’Hispaniola avec la République
dominicaine, dans les Caraïbes.
Le pays est depuis longtemps plongé dans une crise profonde à la fois politique,
sécuritaire, humanitaire, économique et sanitaire. Etat le plus pauvre de la région et
l’un des plus pauvres au monde, Haïti connaît une criminalité importante et les gangs
contrôlent aujourd’hui la plus grande partie de la capitale, Port-au-Prince1. En 2024,
ils ont tué plus de 5600 personnes et déplacé plus de 700 000 habitants2.
Parallèlement, 5.4 millions d’habitants – près de la moitié de la population – souffrent
de la faim et près de 35 000 cas de choléra sont recensés au 20 juin 20243. Enfin, le
pays est régulièrement exposé aux catastrophes naturelles, dont le séisme de 2010
qui a laissé de graves séquelles.
Haïti a une population (11,7 millions) et une superficie (27 560 km2) similaires à
celles de la Belgique mais un PIB 30 fois moindre (19,85 milliards de dollars).
Comment expliquer le sous-développement chronique du pays ? Certes, la mauvaise
gestion de l’île et la corruption sont réelles, mais les ingérences extérieures ont aussi
contribué à la crise pluridimensionnelle et à la misère persistante qu’endure Haïti. Un
retour sur l’histoire du pays, y compris sur le rôle joué par l’ONU, s’impose pour saisir
toute la complexité de la situation et tenter d’expliquer comment les gangs en sont
arrivés à contrôler le pays.
Révolution haïtienne et « double dette »
Dès le XVIIème siècle, la France établit la colonie de Saint-Domingue sur la partie occidentale de l’île d’Ayiti. Des centaines de milliers d’esclaves africains y sont employés à la production de denrées coloniales.. Le pays est alors surnommé la perle des Antilles pour sa beauté et sa prospérité économique.
En 1791, le peuple haïtien, mené par Toussaint Louverture, se soulève face aux 25 000 hommes de l’armée napoléonienne4. Le 1er janvier 1804, les Haïtiens proclament leur indépendance, devenant ainsi la première nation issue d’une révolte d’esclaves et la plus ancienne république noire au monde5.
Fait moins connu, en 1825, la France envoie des navires de guerre et impose un ultimatum : sous peine de guerre, Haïti se voit obligé de verser une indemnité de 150 millions de francs, en échange de la reconnaissance de son indépendance. En outre, Haïti ne pourra emprunter à cet effet qu’auprès de banques françaises – c’est le fardeau de la « Double Dette ». Haïti s’acquittera de sa dette en payant les derniers intérêts en 19476, ayant versé en tout à la France un montant d’une valeur correspondant à 560 millions de dollars en valeur actualisée.
Cette dette a lourdement pesé sur des générations, détournant des ressources qui auraient pu être investies dans l’éducation, les infrastructures et le développement économique7. Les paiements à la France auraient coûté à Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars en perte de croissance économique sur la longue durée, soit jusqu’à huit fois la taille de l’économie entière d’Haïti en 2020. Entre 1915 et 1934, le pays est occupé par les Etats-Unis qui captent les flux de richesse produite ; cette période est marquée par le travail forcé, la torture, la famine et l’exécution d’un grand nombre de Haïtiens.
La dictature et la naissance des gangs
De nombreux coups d’Etat marquent l’histoire d’Haïti et plongent le pays dans l’instabilité politique. La corruption est profondément ancrée et les pots-de-vin sont monnaie courante. Après le remboursement de la dette en 1947, et l’accession au pouvoir de François Duvalier, les espoirs d’un avenir meilleur sont rapidement déçus. Ce dernier met en place une dictature brutale et sanguinaire, les violences se multiplient. Son fils lui succède et le pays continue de s’enfoncer dans la misère, les Duvalier détournant à leur profit des millions de dollars8. Leur dictature s’appuie appuyée sur des gangs armés, dans un contexte de grande fragilité institutionnelle et économique. En 1959, François Duvalier crée le premier groupe paramilitaire, dénommé « Tontons Macoutes », pour le protéger d’un potentiel coup d’Etat de l’armée et pour éliminer ses opposants politiques. Deux ans après leur création, les Macoutes sont deux fois plus nombreux que les soldats de l’armée régulière. La chute du duvaliérisme en 1986 fait naître des espoirs de démocratie. Mais en 1991, le président Jean-Bertrand Aristide est renversé par un coup d’Etat militaire, fomenté en partie par d’anciens membres des Macoutes. Cela débouche sur une autre invasion américaine “pour la restauration de la démocratie” aux côtés de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), en 1994, qui doit rétablir le président, renforcer la police et désarmer les groupes armés, créés par d’anciens membres des Macoutes, qui commettent extorsions de fonds et assassinats politiques9. Aristide retrouve le pouvoir entre 1994 et 1996, puis entre 2001 et 2004. Mais ces groupes armés continuent d’agir et constituent la base des gangs organisés d’aujourd’hui.
Un pays gangrené par la violence et les gangs
Le vide institutionnel et la succession de crises que connaît le pays dans les années 2000 favorisent le développement des groupes armés. Le bilan humain du terrible séisme de 2010 est catastrophique : 230.000 morts, 300.000 blessés et 1,5 million de déplacés10). Des milliers de condamnés s’évadent de prison, semant le chaos, la reconstruction du pays est entravée par les problèmes politiques internes, la corruption et la fragilité de l’État. Ce contexte permet à nouveau aux gangs de se développer et d’agir en toute impunité.
Actuellement, on estime qu’une centaine de groupes se partagent les 2/3 du territoire national et 80% de la capitale, les deux plus influents étant Chen Mechan et 400 Mawozo. A Port-au-Prince, des barrages tenus par des individus armés entravent les circulations sécurisées vers le reste du pays. Les gangs rackettent, kidnappent et rançonnent des citoyens haïtiens et étrangers et participent au trafic d’armes et de drogue12. L’argent sert à acheter des armes, souvent importées illégalement des Etats-Unis. Dans la capitale, des gangs pratiquent la politique de la terre brûlée – détruisant les quartiers de leurs rivaux – et tuent, blessent, violent ou enlèvent des citoyens13. Les résidents sont contraints de rester reclus ou de fuir leur logement. Selon l’ONU, les violences ont causé la déscolarisation de plus de 500 000 enfants.
Les forces de l’ordre sont débordées, face aux gangs dont la puissance de feu est sans doute supérieure à celle de la police et de l’armée réunies. Cependant, des experts pointent des liens de plus en plus étroits entre les gangs et les plus hautes instances de la police et du gouvernement, qui leur fournissent fonds et matériel, pour maintenir leur emprise sur certaines zones du pays. Certains chefs de gangs offrent une protection aux habitants de leur territoire à condition qu’ils se soumettent à leur autorité, et sont parfois perçus comme des bienfaiteurs par la population. Le chef très connu du gang G9 , Jimmy Cherizier, alias « Barbecue », lui-même issu de la police, s’impose comme un véritable chef d’État sur son territoire.
Le rôle de l’ONU
Suite au départ du président Jean-Bertrand Aristide, et face à la profonde instabilité du pays, le Conseil de Sécurité des Nations Unies vote la Résolution 1542, qui met en place la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Cette dénomination renvoie à une multitude d’activités coordonnées par les forces militaires onusiennes ainsi que les différentes agences (PNUD ; OIM ; UNICEF ; UNHCR). Elle se distingue des opérations précédentes de l’ONU en Haïti par son approche holistique, tout en maintenant un objectif spécifique de sécurité et de droits de l’homme, au cœur de la résolution 1542. Déployée de 2004 à 2017 , la MINUSTAH aura été l’une des opérations les plus importantes de l’ONU, avec un coût un total de 4,5 milliards de dollars, un pic de 8744 militaires et 3240 policiers en 2010-2011, et, pour cette année là, un budget de plus de 850 millions de dollars, soit 50% des dépenses publiques du gouvernement haïtien et 10,7% du PIB.
La MINUSTAH combat le crime organisé et permet de reprendre aux gangs armés de nombreux quartiers, faisant ainsi chuter les nombres d’homicides et de kidnapping. Sa fonction stabilisatrice consiste également à professionnaliser et augmenter les rangs de la police nationale haïtienne, ainsi qu’à la dépolitiser le plus possible. Leur nombre passera de 0,4 à 1,3 agents de police pour 1000 habitants (dont 10% de femmes). Elle soutient également les processus législatifs menant aux projets de code pénal, code d’instruction criminelle et de loi pénitentiaire.
Cependant, les morts violentes de civils, l’épidémie de choléra transmise par un de ses contingents, et l’exploitation sexuelle des Haïtiens ont considérablement terni son image. Les forces onusiennes ont été accusées de faire usage d’une force systématiquement disproportionnée, en recourant à de l’artillerie lourde dans des quartiers densément peuplés. En effet, le commandement brésilien en charge des opération militaires onusiennes, avait choisi une approche militarisée, légitimée par la criminalisation de quartiers entiers, comme dans les favelas brésiliennes. Haïti devait ainsi servir de laboratoire aux forces militaires brésiliennes pour convaincre leurs autorités politiques de systématiser cette approche dans les favelas de Rio, alors qu’elle contrevient au principe même d’état de droit.
La deuxième controverse majeure concerne le rôle de la MINUSTAH dans l’épidémie de choléra qui suivit le terrible tremblement de terre de 2010. Entre 2010 et 2022, le pays enregistre plus de 820 000 cas et 10 000 décès causés par cette maladie, qui n’y avait jamais été introduite auparavant. Les casques bleus népalais, pourtant originaires d’une ville frappée par une épidémie, n’avaient pas été testés pour le choléra, mais n’avaient pas non plus mis en place de mesures sanitaires destinées à en freiner la propagation. Leurs eaux usées, directement rejetées dans les rivières, ont contaminé des habitants. Pendant des années, les conclusions des rapports de l’ONU éviteront de pointer sa responsabilité directe. Il faut attendre 2016 pour que le Secrétaire général Ban Ki-moon s’excuse brièvement auprès de la population haïtienne et accepte la responsabilité morale de l’ONU, mais non sa responsabilité légale. La bataille scientifique laissa ainsi place à celle portant sur la responsabilité des Nations Unies, devant les cours internationales. Il est pertinent de souligner la complexité de ce débat : l’ONU peut-elle être tenue pour responsable de ses actes ? l’ONU jouit de l’immunité de toute forme de juridiction afin de préserver son indépendance en tant qu’organisation internationale. Cette immunité est donc destinée à prévenir les attaques politiques sans fondement qui pourraient gêner le travail de l’institution. Or il s’agit dans ce cas de la négligence que cette immunité a favorisée. Bien qu’un nouveau plan de lutte contre le choléra de 400 millions de dollars, financé par les contributions volontaires provenant des excédents de la MINUSTAH soit annoncé en 2016, seuls 21,8 millions ont été réunis en 2021.
La dernière controverse majeure concerne les accusations de crimes sexuels commis contre la population haïtienne, notamment des mineurs, comme moyen de transaction contre nourriture et médicaments. Ces abus furent rapportés par les « MINUSTAH Wives » dont les enfants ne furent pas reconnus par leur géniteurs, membres des forces onusiennes. Un grand nombre de ces abus ne firent jamais l’objet d’enquêtes approfondies. Si tel était le cas, rares sont les accusés qui en ont subi les conséquences une fois rentrés dans leur pays, et rares sont les victimes à avoir bénéficier d’une compensation ou d’une assistance. La mission est ainsi l’une de celles ayant compté le plus grand nombre d’accusations d’abus sexuels à l’encontre de son personnel. De plus, les données rapports confidentiels faisant état de ces actes ne sont pas transmis aux enquêteurs. L’ONU n’a jamais tenu le gouvernement haïtien pour responsable de son inaction face aux violations des droits humains. Ces controverses ont renforcé la méfiance de la population vis-à-vis de toute forme d’intervention étrangère.
L’après MINUSTAH
Le départ des forces onusiennes en 2017 laisse un pays et un régime bénéficiant d’un soutien international, une armée reconstituée, une opposition divisée, et des gangs sont toujours présents. La police est désormais une institution professionnalisée grâce à leur formation par la MINUSTAH, ce qui réduit les risques de son utilisation comme outil répressif. Cependant, Haïti n’est jamais parvenu à consolider son processus démocratique.
L’assassinat du président Jovenel Moise, en 2021, aggrave l’instabilité, que connaît le pays encore à ce jour. Son premier ministre, Ariel Henry, n’ayant pas prêté serment et les législateurs arrivant en fin de mandat, ils ne sont pas en mesure désigner un remplaçant pour assurer l’intérim. Un accord politique conclu en décembre 2022 prévoit de nouvelles élections en 2023, l’investiture d’un nouveau président en février 2024 et la mise sur pied d’un Haut Conseil de Transition (HCT). Hormis pour le HCT, l’accord ne sera pas mis en œuvre. Le Premier Ministre se maintient au-delà de son mandat. Des manifestations contre le gouvernement ont lieu dans tout le pays, en partie encouragées par des figures populistes et d’opposition. Le blocage politique empêche toute réponse à la crise sécuritaire et humanitaire liée à la violence des gangs, aux pénuries de nourriture et de carburant ainsi qu’au retour du choléra. Les appels à la démission du premier ministre se multiplient.
À la requête de Ariel Henry, le Conseil de Sécurité de l’ONU vote la Résolution 2699 en octobre 2023. Elle autorise le déploiement de la Multinational Security Support Mission (MSSM) en Haïti, pour soutenir opérationnellement la Police Nationale Haïtienne contre les gangs, sécuriser les infrastructures principales et s’assurer du passage de l’aide humanitaire. Cette mission n’est pas menée par l’ONU et est financée par des contributions volontaires. Le Kenya s’est porté volontaire pour la mener avec un déploiement de 1000 agents de police, espérant 1500 agents supplémentaires issus de contingents d’autres contributeurs. Cette initiative fut cependant contrecarrée par la Haute Cour de Justice kényane pour des raisons de procédure.
Face aux appels nationaux et internationaux à la démission du premier ministre, le gouvernement kényan conditionne le déploiement de son contingent au départ de Henry. Ce dernier finit par se résigner le 11 mars 2024. Un Haut Conseil de transition (HCT ) est mis en place.
Trois défis pour la MSSM. Tout d’abord, son financement, par des contributions volontaires, n’est pas durablement assuré. Sur les 600 millions de dollars annuels nécessaires, 400 ont pour l’instant été réunis. Ensuite, la mission se distingue en principe des précédentes par l’inclusion de la société civile dans la conduite de ses activités. Mais la fragmentation de la société haïtienne empêche celle-ci de s’exprimer d’une seule voix. Enfin, la mission hérite de la réputation très contrastée de celle qui l’a précédée, et donc de la méfiance de la population.
Lors des négociations au Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat en septembre 2024, le HCT a souhaité qu’elle devienne une mission formelle de maintien de la paix, menée par l’ONU, notamment en raison des problèmes de financement. Des modèles alternatifs, dans lesquels l’ONU fournirait un soutien logistique à la mission sans en changer la nature, ont également été évoqués. Ces discussions s’inscrivent dans un contexte plus large de redéfinition du maintien de la paix, et d’exploration de nouveaux modèles pour répondre aux enjeux sécuritaires actuels.
Après le départ de Ariel Henry, le Conseil présidentiel de la Transition (CPT) a remplacé le HCT. Les autorités haïtiennes étatiques ont pris l’engagement d’organiser des élections générales en 2025, les premières depuis 2016, avant que n’arrive à échéance le mandat du CPT le 7 février 2026. Enfin, le pays est toujours sans députés depuis 2020.
Derniers développements
Le 22 janvier 2025, le Chancelier (ministres des affaires étrangères) haïtien, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a participé à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la crise sociopolitique et sécuritaire en Haïti. Il a salué les progrès de la Police Nationale d’Haïti (PNH), soutenue par la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS), tout en appelant à transformer cette mission en opération de maintien de la paix de l’ONU. Insistant sur l’urgence d’agir face aux souffrances de la population, il a exhorté la communauté internationale à intensifier son appui. Les membres du Conseil et plusieurs partenaires internationaux, dont la République dominicaine, la Colombie, le Canada et le Kenya, ont exprimé leur soutien à une solution durable pour Haïti.
Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a alerté sur le risque d’un effondrement total de l’autorité étatique à Port-au-Prince si un soutien international accru n’est pas apporté à la police nationale haïtienne. Lors d’un rapport présenté au Conseil de sécurité, il a averti que des retards supplémentaires dans le renforcement de la force multinationale dirigée par le Kenya pourraient permettre aux gangs de prendre le contrôle de la capitale. Actuellement, la force compte environ 600 agents, bien en deçà des 2 500 prévus. Guterres a appelé à une action urgente pour éviter une telle catastrophe.
Rédigé par Thomas Lennon et Quentin Moussebois, APNU Jeunes